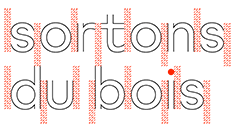Devant jouer un rôle de signal fort, la conception du projet s’est axée autour d’un élément architectural emblématique et d’un traitement paysager singulier, permettant ainsi de capter l’attention des visiteurs et touristes aux portes de la plaine d’Alsace. La localisation particulière du projet, situé sur l’île du Rhin à proximité immédiate de la frontière allemande mais aussi des villes médiévales de Breisach et Neuf-Brisach, nous a conduit à concevoir notre proposition autour des lignes de force parallèles au fleuve, tel un « bateau » immobile s’appuyant sur la plateforme actuelle jusqu’à sa proue.
L’édifice haut et linéaire est inspiré des cribs qui s’apparentent à de grandes armoires extérieures de stockage des épis de maïs. Cette conception architecturale offre des pièces à vivre, bureaux, lieux d’exposition, cafétéria, s’inscrivant dans ce parallélépipède tels des tiroirs actionnés dans un meuble de quincaillerie.
Le projet paysager vient conforter cette verticalité en offrant un véritable parc s’entremêlant au bâtiment. À son sommet, une immense plateforme belvédère se développe sur toute sa surface, offrant des vues exceptionnelles sur le site et outre-Rhin.La structure complètement colonisée par des plantes grimpantes est également composée de terrasses conviviales, de salles de fraîcheur, de petits salons urbains ainsi que d’aires de jeux et de potagers aériens.